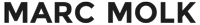Interview with MARC MOLK (in french) / D-FICTION
Read the interview on the D-Fiction website : https://d-fiction.fr/entretien-avec-marc-molk/
********************************
“MARC MOLK s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son allocution au Collège de France, LA RAISON SENTIMENTALE (ENd Éditions, 2017), préfacée par Claudine Tiercelin :
1 – Marc, tu es d’abord un plasticien et plus spécifiquement un peintre. Mais la peinture est devenue une activité et un médium plutôt déconsidérés par le milieu des arts plastiques même si la peinture reste encore ce qui se vend le mieux. Que penses-tu de cette situation aujourd’hui ? Qu’est-ce qui t’a fait utiliser le médium de la peinture avec toile, châssis, pinceau, etc. ? Pour toi, à l’heure du numérique, de l’image de synthèse, mais également des méga installations de certains plasticiens, la peinture est-elle encore « puissante » à dire, à montrer, à faire ressentir et à interpeller ?
La situation a beaucoup changé depuis une dizaine d’années. Elle s’est tout bonnement retournée. La peinture est maintenant totalement revenue en grâce, et si j’étais un artiste conceptuel, je dormirais mal la nuit. Qu’ils se rassurent cependant car les peintres sont des êtres plus complets qu’eux et nous ne prorogerons pas la guerre à mort qu’ils nous ont menés pendant quarante ans, maintenant que nous avons l’avantage. Pas par hauteur d’âme, mais au fond parce qu’ils n’ont jamais compté à nos yeux, les petits staliniens du duchampisme, les cafards de l’art institutionnel, ces champions du bric-à-brac subventionné. Ils ont bricolé, ils ont enchaîné mille blagues à Toto vaguement malines, ils ont pondu de la réflexion creuse au kilomètre, à eux la gloire passée d’un style inepte et d’une production paradoxalement insignifiante. Le vent a beau souffler, quand il cesse de souffler, et il a cessé, il n’en reste rien. Donc tout va bien, l’Image a repris sa place naturelle, charismatique, pile au centre de l’Imaginaire contemporain.
2 – En octobre 2014, la philosophe Claudine Tiercelin, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Métaphysique et philosophie de la connaissance t’a invité à diriger un colloque sur la peinture : La Fabrique de la Peinture, au cours duquel tu as donné une allocution passionnante, intitulée La Raison sentimentale. Peux-tu revenir pour nous sur cette expérience : quel est l’enjeu pour un artiste d’aller parler au Collège de France de peinture comme tu l’as fait ? En quoi une allocution au Collège de France permet-il de faire comprendre des choses qui ne sauraient être entendues ou saisies par ailleurs ? Comment une allocution académique influe-elle sur le discours de l’art aujourd’hui ? Cela t’a-t-il permis d’échanger ensuite, autrement et mieux, avec le milieu artistique ? Qu’as-tu ressenti en réussissant à réaliser une telle allocution ? Comment l’allocution, en tant que forme performative, participe-t-elle d’une performance artistique ?
J’ai davantage la sensation d’avoir mené une action politique en dirigeant ce colloque. Politique au sens gramscien du terme, c’est-à-dire que j’ai mené une bataille décisive au sein d’une guerre culturelle, celle dont je parlais précédemment, qui était livrée contre la peinture, l’acte de peindre lui-même. Nous avons rassemblé 14 peintres, de Jeff Koons à Chéri Samba en passant par Jules de Balincourt, ayant tous des techniques très différentes car il s’agissait d’explorer ce que la parole des peintres sans intermédiaire pouvait apporter à la Philosophie de la connaissance, explorer la richesse poïétique qu’offrait la peinture contemporaine, et donner à voir son foisonnement. Ce colloque a été un tournant majeur dans le milieu de l’art en France, je le dis sans modestie car c’est la vérité. La salle de 450 places est restée pendant trois jours pleine à craquer, les allées elles-mêmes étaient peuplées de gens assis et une forêt de visiteurs debouts étaient là pendant des heures écoutant les différentes communications. Toutes les interventions ayant été rendues disponibles en vidéo sur le site du Collège de France, cette énorme discussion de fond, polyphonique, a été visionnée depuis 2014 des centaines de milliers de fois. Ce colloque figure parmi ceux les plus visionnés du site du Collège de France. Je crois que nous avons accéléré le renversement, que nous l’avons officialisé, que nous avons démontré en acte l’inanité de l’incroyable projet d’annulation (la cancel culture ne date pas d’hier) dont avait été victime la peinture en France depuis quarante ans. Ce colloque a « tué » « la mort de la peinture. Tous les peintres de France et de Navarre, entre autres, l’ont visionné en entier et plusieurs fois. Chaque intervention possède sa version en langue anglaise, et il a donc été suivi dans le monde entier. Je suis extrêmement fier de ce travail collectif, extrêmement reconnaissant à Claudine Tiercelin de m’avoir offert l’occasion de le mener, extrêmement confiant dans le pouvoir encore actif que possède ce colloque de servir de socle de légitimité aux jeunes peintres à venir. Je suis un serviteur de la Peinture, quand je peins, quand je parle, quand j’écris. Nous avons mis 14 balles en platine dans la tête de nos ennemis durant ces trois journées studieuses. Nous sommes en 2020 aussi je peux vous le dire : ils ne s’en sont pas relevés.
3 – Ton allocution au Collège de France a fait l’objet d’une publication en 2017, préfacée par Claudine Tiercelin que nous publions à notre tour, et qui nous donne ainsi l’occasion, plus ou moins sur le tard, de cet entretien. C’est une préface admirable à plus d’un titre. On y retrouve l’esprit de cette philosophie qui nous est si chère, et dont Claudine Tiercelin est la représentante française la plus emblématique: le pragmatisme. En déclarant ainsi que « peinture, amour et raison vont de pair » et exigent « beaucoup de savoir faire, une réelle « connaissance pratique », elle souligne parfaitement que tout véritable art découle avant tout d’une subjectivation et d’une imagination propres à la confrontation physique et à l’expérience phénoménologique qui n’ont rien à voir avec le « savoir » conceptuel et théorique (différent également de ce « savoir-faire » qu’elle évoque aussi) et que revendiquent tant d’artistes dont les œuvres ont évacué tout « vécu », et pour aller vite, nous dirions aussi toute « âme », de leur geste artistique, concevant leur œuvre davantage comme une fin que comme un moyen, c’est-à-dire comme une posture (capitalistique, médiatique, sociale) plus que comme une réelle nécessité existentielle menant à la « connaissance » de ce « connais-toi toi-même » qui devrait être pourtant la seule véritable motivation d’un artiste ou d’un écrivain. Claudine Tiercelin insiste à plusieurs reprises à ce propos : « Marc Molk est sûrement plus proche d’une telle attitude anti-intellectualiste de la connaissance », ou encore « Marc Molk ne veut pas choisir entre sentir et penser, entre peindre et écrire, entre peindre et vivre, car « la vie s’étudie dans les tableaux et la peinture se perfectionne dans la vie ». Parle-nous donc de ce rapport à la « connaissance », c’est-à-dire en fait simplement à la vie, à cette phénoménologie artistique qui est la tienne et à travers laquelle tu t’exprimes car si tu peins avec de la peinture, tu peins d’abord à partir de sensations et de perceptions subjectives, personnelles, ressenties en dehors des « clous », des modes, des bien-pensances, à la manière du pragmatiste William James qui rejetait l’avis des savants, leur autorités et leurs vues, concernant la réalité et la description qu’ils en donnaient, estimant qu’elle ne pouvait être totalement « vraie » du fait, disait-il, que « leur champ d’action est extrêmement limité […] » et qu’ils ne « font autorité, généralement, qu’en matière de méthode […] ». Qu’est-ce que cela fait d’être analysé par une philosophe de l’importance de Claudine Tiercelin? Comment votre dialogue t’a-t-il amené à penser cette allocution au Collège de France, comme à réfléchir à ta pratique artistique ? Qu’apportent les échanges transdisciplinaires à tes yeux ?
Mon dialogue avec Claudine Tiercelin a commencé à l’atelier car je l’ai rencontrée quand elle est venue voir ma peinture. Nous avons parlé ensemble facilement cinq heures, de peinture, de création, de tout. Je ne suis évidemment pas capable de philosophie au niveau qui est le sien, mais nous avons réussi à échanger d’une manière surprenante. Étrange phénomène, imprévisible : avoir quelque chose à dire à quelqu’un. Je crois pouvoir dire ici sans trahir un secret que nous sommes depuis devenus amis. Sur bien des points, je ne suis pas d’accord avec elle et elle ne l’est pas avec moi. Je veux dire par là qu’elle n’a jamais usé d’un quelconque argument d’autorité pour me faire taire ou invalider mes propos, et que je me suis toujours senti libre d’exprimer mes opinions. Je peux dire d’elle qu’elle estime et respecte les idées pour ce qu’elles sont en soi. J’ai rarement croisé quelqu’un aussi attaché tout à la fois à la vérité, à la rigueur d’un raisonnement et à la raison agissante de son interlocuteur. J’ai rarement été autant et aussi finement « écouté » au fond, et ce qu’elle m’a dit m’a fortement marqué à nombre reprises. Je crois que la peinture et la philosophie ont quelque chose d’essentiel en commun : ce sont des entreprises de représentation. Elles possèdent plusieurs ressorts identiques. Concernant la peinture elle-même, c’est un espace d’expérimentation me concernant. Je ne suis préoccupé ni de productivité ni d’uniformité du style. Cela a produit un parcours difficilement identifiable. Beaucoup dans ce milieu me regardent de travers, souvent gênés, je crois parce qu’ils ne peuvent ni m’ignorer complètement ni m’apprécier sans se demander pourquoi. Je ne comprends d’ailleurs pas moi-même « ce que je fais en peinture ». Je suis là, c’est tout. J’ai fait la paix avec cette sensation d’être « à la périphérie du champ ». Parfois cela m’inquiète, puis je me souviens que je compte parmi mes amis proches plusieurs artistes dans différents domaines qui m’accordent leur crédit, alors je me dis « continue, tu verras bien », mais honnêtement, je suis comme les autres. J’aurais tendance à ne pas pouvoir m’étiqueter, me situer précisément sur la carte. Il se peut que ce soit une simple inadéquation, mais j’espère évidemment qu’une logique habite cette trajectoire, une logique malheureusement encore un peu obscure.
4 – Parlons plus explicitement de tes premières peintures. Elles ont une dimension sociétale forte. Peux-tu nous expliquer le sens de ta démarche, l’engagement qui a été le tien et quelle a été l’importance à tes yeux de « témoigner » d’événements sociaux ou de « défendre » des valeurs politiques à travers le geste artistique du dessin et de la peinture ? Peux-tu ainsi revenir pour nous sur quelques-unes de tes performances à partir et à l’aide de tes peintures devant le 10, Downing Street à Londres, à la Maison des arts de Malakoff, ou encore concernant ton portrait de Nicolas Sarkozy ? Est-ce important de prendre des risques physiques, psychologiques, voire judiciaires (comme les prend également Deborah de Robertis) lorsqu’on est un artiste ? Trouves-tu que beaucoup d’artistes prennent aujourd’hui encore ces risques permettant de faire bouger les lignes de forces qui astreignent et étreignent la société ? Tu as pu ainsi t’exprimer sur la chaîne Arte concernant une représentation de la Shoah à travers la peinture que tu as réalisée : Le Stade du Vel’ d’Hiv’. Qu’est-ce qui t’a décidé à peindre cette toile ? Comment t’es-tu confronté à cet événement historique hors norme, et comment te situes-tu pas rapport à ceux qui, comme Claude Lanzmann ou Jacques Rivette, estiment que l’holocauste est une « représentation impossible » et que le principe même de vouloir la fictionnaliser à travers des « images » est trivial, voire abjecte ?
J’ai arrêté il y a plusieurs années de pratiquer une peinture explicitement politique. D’ailleurs la politique elle-même, comme on l’entend, ne me concerne plus du tout. Il me semble à présent que le champ psychologique, sentimental, est plus riche et satisfaisant à explorer. L’intime a toujours le dernier mot et le destin du monde m’indiffère à présent. Hormis la poignée d’êtres humains que j’aime pour de bon, et ceux que j’estime de loin, tout les autres pourraient bien mourir en s’entre-dévorant ou d’une pandémie foudroyante, je m’en tamponne. Nous vivons tous dans un quasi désert humain et les chiffres des démographes ne désignent que des milliards de figurants, les éléments d’un décor abstrait. Il faut constater le vide et ne pas s’encombrer mentalement de la grande armée de pantins qui nous entourent. Je suis évidemment moi-même, aussi, un figurant, un pantin pour ces ombres qui m’indiffèrent tant. Pour eux, je fais partie du grand décor. C’est la règle du jeu et cela me va parfaitement. J’apprécierais d’ailleurs que certains, pour qui par hasard je suis devenu un peu plus que cela, m’oublient tout à fait. Cela me ferait des vacances. Concernant Le Stade du Vel’ d’Hiv’, j’en ai fait une seule de ce type. Je refusais de ne pas peindre cette scène alors même qu’elle était, en terme d’art contemporain, à la fois « tabou » et « racoleuse ». Il m’a semblé que le courage ici était d’assumer justement ce procès en racolage et d’ignorer ce tabou. J’ai toujours refusé de la vendre ou de simplement l’exposer. Elle existe pour ce qu’elle est, c’était le but initial.
5 – Tu as réalisé en 2018 de nouvelles performances, entre autres, lors du festival Extravadance au Centre Pompidou. En quoi consistaient-elles et que t’ont-elles permis de revendiquer ou défendre cette fois ?
J’ai récité « Une allée du Luxembourg » en me trompant sur le dernier mot du premier quatrain, à trente reprises différentes, pour finalement « retrouver » soudain le mot original, être en mesure de poursuivre ma récitation, et finir le poème. Au début, le public a cru à un trou de mémoire malaisant, puis le procédé a été compris, et j’ai décliné trente mots alternatifs. Le public a fini pas écouter le poème sous-jacent, puisque ces mots erronés à la suite définissait un champ lexical précis, celui de la perte d’un amour immense, unique, en somme l’exacte contraire de la perte décrite par le poème de Nerval, qui concerne une simple passante, inconnue et fugitive. Je venais de vivre cette expérience et j’étais dévasté, dans un état critique. Je crois que c’est à ce jour ma meilleure performance parlée, parce que j’espérais que la femme à laquelle ce poème piraté était destiné serait dans le public, cachée ou debout devant tous les autres. J’ai appris le lendemain qu’elle n’était pas venue. Quand ça veut pas, ça veut pas.
6 – Il y a aussi certaines de tes toiles qui évoquent non plus l’espace public, mais plutôt l’intime, le privé, le secret… Qu’essaies-tu alors de faire passer dans ses toiles? Quelles sont tes motivations lorsqu’il s’agit de peindre l’intime ? S’agit-il ici d’une forme d’autofiction par l’ « image », et non plus seulement par les mots ?
Je l’ai cru à une époque, mais je ne sais plus vraiment. Je crois que j’ai longtemps essayé de « dire » avec la peinture au lieu de « montrer », et que c’était une erreur. J’ai la sensation que « ma » peinture est devant moi et que tous mes tableaux précédents m’ont tenu lieu de propédeutique. J’imagine que c’est une sensation commune et qui ne me quittera jamais, mais à certaines époques de nos vies, cette sensation est beaucoup plus forte. J’aurais donc beaucoup de mal à m’expliquer ici d’une façon construite et convaincante car je traverse un flou total en ce moment, et si j’exposais mes certitudes passées, je produirais un discours mort, fossile. Bref, je ne sais vraiment pas quoi dire hic et nunc. Plus tard peut-être, dans un an ou deux.
7 – Tu as réalisé des calligrammes à partir de textes classiques qui prennent des formes sophistiquées de squelettes et de sexe. Plusieurs de ces calligrammes sont inclus dans l’Anthologie de la poésie érotique contemporaine (Garnier, 2018). Est-ce du dessin littéraire ou de l’écriture plasticienne ? Quel est ton projet à terme ? Peux-tu également revenir pour nous sur tes « dessins mouillés » ? De quoi s’agit-il comme technique et surtout comme idée artistique ? Comment es-tu arrivé à réaliser ces dessins ? Que comptes-tu développer et montrer à travers eux ? Est-ce différent de dessiner que de peindre pour toi ? Qu’est-ce que le dessin permet que ne te permettrait pas la peinture ?
C’est une fusion, principalement parce que mes calligrammes sont manuscrits. La main y est omniprésente. Je crois que leur niveau de sophistication graphique en fait des œuvres proprement visuelles à part entière. J’ai récemment commencé à réaliser des calligrammes « augmentés », c’est-à-dire rehaussés d’éléments graphiques indépendants du calligramme lui-même. J’éprouve aussi le besoin de faire figurer (j’adore cette expression, « faire figurer ») de l’écriture dans mes tableaux, mais pour l’instant pas sous la forme de calligrammes intégrés à l’image, plutôt en jouant sur l’esthétique de la brique élémentaire du langage écrit : la lettre. Mais c’est très casse-gueule, car ce champ a pour le coup été sillonné déjà par nombre de peintres depuis des siècles et le piège célèbre de l’illustration ou celui de la simple décoration n’est jamais loin. Garder vive l’exigence de pertinence du surgissement de l’écriture dans l’image est une véritable discipline qui rend ce geste précis très complexe à concevoir et à produire. Concernant les dessins mouillés, je les ai totalement arrêtés. Principalement parce qu’ils ont tous fini pour des raisons techniques par disparaître, littéralement. Les encres qui se dissolvent à l’eau se dissolvent au soleil. Les UV ont eu raison de ces dessins. C’était un crève-cœur. Et quand on utilise des encres solides à la lumière, elles refusent de se dissoudre à l’eau, même un tout petit peu. On ne peut pas conserver ce qui est essentiellement fragile. Il faut choisir, et la poétique de la disparition coûte trop cher en terme de simple sensation de perte.
8 – Les titres de tes toiles sont souvent très « littéraires », des sortes de métaphores. Le titre précède-t-il toujours la peinture et le dessin ? Les œuvres deviennent-elles programmatique d’un titre, d’une posture « poétique » ou « philosophique » dont la totalité réunie, à terme, formerait une sorte d’œuvre parallèle ? Dirais-tu que tu peins et écris avec le même « regard » sur les choses de la vie, et que ces deux médium illustrent la même chose de ta pensée, mais différemment ?
Non, le titre arrive après ! C’est un genre d’exhausteur sémantique à la manière du sel de Guérande sur n’importe quel plat. Enfin, idéalement bien sûr, quand on trouve le bon titre, celui qui catalyse le tableau. L’Origine du Monde par exemple, ce tableau formidable, s’il s’était appelé La Chatte à Ginette n’aurait pas la place qu’il tient dans l’univers mental occidental et dans l’histoire de l’art. Le titre est donc, à bien des titres, accessoire, mais à bien d’autres, substantiel. C’est le dernier coup de pinceau. Il s’agit de ne pas le rater.
9 – Tu as conçu une première monographie avec nous, consacrée à tes seules peintures, Marc Molk : Ekphrasis (D-Fiction & Label hypothèse, 2012). Chacun des textes en vis-à-vis de tes toiles ont été rédigés par un écrivain. Tu as tenu à ce que ce ne soit que des écrivains qui rédigent ces textes et que ces textes ne soient aussi, d’ailleurs, que des fictions sous forme d’ekphrasis, ce qui – à notre connaissance ne semble n’avoir encore jamais été réalisé par aucun artiste à l’époque. Peux-tu nous dire pourquoi tu ne tenais pas à ce que ce soit un essayiste, un critique d’art, qui parle de ton travail ?
La critique d’art est possible, mais elle n’est plus pratiquée. Plusieurs raisons rendent ce type d’analyse quasiment impossible de nos jours, ou en tout cas inaudible. La disparition célébrée de toute échelle de valeur, l’agonie bienvenue d’une conception hégélienne de l’Histoire en général, et de l’Histoire de l’Art en particulier, la misère intellectuelle de la plupart des agents de ce milieu, qui ne sauraient distinguer une véritable critique d’art d’une courgette, leur intérêt à ce que la « critique d’art » ne soit plus qu’une machine à produire du texte hagiographique pour communiqué de presse rétribué manu à manu, j’en passe… Enfin, et il faut le dire, la critique d’art n’est pas indispensable, c’est un plus, mais tout le monde peut s’en passer, comme on peut très bien se passer des critiques gastronomiques, et se remplir la panse sans réfléchir. Chacun se nourrit très bien à l’instinct, opportunément, et presque à l’aveugle. Ce constat était déjà le mien en 2012 alors quand il s’est agit de textes pour mon catalogue, je me suis épargné le simulacre de textes estampillés « blabla pointu mon cul labelisé », et je leur ai préféré des textes d’écrivains qui possédaient leur propre nécessité. Ce catalogue contient par ailleurs un long entretien avec Jean-Yves Jouannais, lui-même artiste et dont la culture est à la fois profonde et buissonnière. Il m’a posé des questions à la manière d’un psychanalyste de la création. C’était pointu, dérangeant, bienveillant, mais sans concession. Bref, je ne crois pas qu’il faille renoncer à toute réflexion, à toute tentative d’analyse, je dis seulement que rares de nos jours sont les occasions de mener ce type d’échappées belles efficacement. La branlette intellectuelle de haute qualité n’est plus un sport français alors même que nous étions champion du monde. Reste quelques pratiquants, mais la masse des combattants ainsi que le public ont disparu. Il fallait bien que l’effondrement de l’Éducation nationale, la disparition du grec et du latin, la victoire sans appel des écrans sur le livre, finissent par se ressentir en profondeur, à grande échelle. Nous y sommes ! Au loin meuglent les veaux dans les champs de pavots.
10 – Venons en donc à la littérature qui représente un médium très important pour toi dans ton parcours, puisque tu écris. Tu as ainsi publié deux fictions et collaboré à de nombreux recueils collectifs ou revues. Qu’est-ce qui t’a amené à l’écriture, précisément fictionnelle ? Comment as-tu concilié l’écriture et la peinture ?
Tout le monde écrit en fait. J’ai seulement été publié ce qui fait une différence socialement parlant, mais n’est pas significatif « littérairement » parlant. D’ailleurs, entre ce que j’ai écrit qui a été publié et ce qui ne l’a pas été, le hiatus est important. Il est en partie de mon fait puisque j’ai refusé deux publications. Je me remonte du col ici parce que, sur le moment, je me suis rendu compte, à la réaction des éditeurs, que ma décision était un genre de scandale, d’absurdité, presque une insulte à leur endroit. Il n’en était rien. J’avais posé des conditions auxquelles ils refusaient de souscrire. Rien de financier : dans le premier cas, je refusais de trahir mon texte, dans le second, d’en faire la promotion publiquement. Mes conditions étaient peut-être critiquables, ce n’est pas la question, ce que je veux dire ici, c’est que je n’écris pas pour être publié. J’aime être publié, mais c’est la cerise sur le gâteau. Au fond, je m’en tape. Alors, je dirais pour te répondre que l’écriture est pour moi l’espace du caprice absolu. Pas la peinture, ce qui est sans doute inquiétant. Mais un écrit peut survivre et se multiplier sans être publié, tandis qu’un tableau est un objet unique, fragile et prompt à disparaître physiquement. Un tableau a besoin d’exister dans le monde pour survivre à son auteur, un écrit non, pas vraiment.
11 – Ta première fiction, Pertes humaines (Arléa, 2006), est une succession de portraits évoquant des personnes que tu as connues sous la forme de 33 fiches régies selon trois critères que tu nommes des « Indices » et qui nous permettent de suivre le développement de ta relation à ces personnes : « Coefficient de perte », « Part de responsabilité » et « Chance de renouer ». Parles-nous de ce dispositif. Comment l’as-tu imaginé et organisé pour la rédaction ? Penses-tu que ton livre appartienne, de par son objectif volontairement « narcissique » et « biographique », au genre de l’autofiction ? Apprécies-tu généralement ce genre fictionnel en tant que lecteur, ou es-tu plutôt porté vers d’autres genres ?
« Ça le fait ou ça le fait pas » : c’est mon seul crible esthétique. Un projet peut tout déchirer sur le papier et être bof finalement, comme il peut ne rien promettre du tout et se révéler magique par un mystère d’exécution. J’ai écrit ce livre en quinze jours en vacances. Il a beaucoup plu. J’ai reçu des mails d’inconnus qui, m’ayant imité, obtenaient un résultat tout aussi convaincant que moi. La structure en fiches avec indices fonctionne pour n’importe qui. Alors, je dirais que le ressort de ce livre tient davantage au dispositif qu’au style du texte. Je crois de toute façon à deux tamis quand j’écris : l’authenticité et la justesse. Mon style – si style il y a – est une conséquence de ces deux contraintes abstraites. L’authenticité n’est pas le résultat d’un choix de ma part : je n’ai aucune imagination. Alors j’ai fait contre mauvaise fortune bon cœur : j’ai écrit la vérité. Avec le bénéfice surprise d’une grande cohérence automatique de ce que je décrivais, une cohérence parfaite et sans effort, héritée du réel. Si l’on décalque le réel, rien ne fleure le toc, car rien n’est effectivement en toc. Les faiblesses d’un récit surgissent en revanche immanquablement des parts imaginées. Tous les menteurs vous le diront : ce sont les incohérences de détails qui trahissent une cabane. Concernant le souci de « justesse », il m’occupe parce qu’il suffit de trouver les mots exactes pour que la moindre phrase, même la plus modeste, prenne des allures pas possible, littérairement parlant j’entends. Alors voilà, ce livre est ce qu’il est, mais je l’ai écrit avec un souci permanent d’authenticité dans la description et de justesse dans l’expression.
12 – Parmi les personnes qui traversent ce livre, certaines existent vraiment. Tu as conservé leurs prénoms, mais en prenant soin de modifier leurs noms de famille en les coupant à la première syllabe, et en les redistribuant à d’autres personnes. Nous imaginons que cela n’a pas dû plaire beaucoup vu les souvenirs que tu relates… Comment s’est passée la réception de ton livre de ce point de vue ? Espérais-tu, par exemple, pouvoir reprendre certains contacts puisque le bandeau du livre annonçait: « Ceux qui s’éloignent imperceptiblement alors qu’ils comptent pour de bon… » ?
Je n’avais aucune idée qu’un livre produisait des « effets ». Quand je l’ai écrit, je n’avais jamais été publié et je comptais mes chances de l’être pour presque nulles. Je m’amusais à l’écrire. C’était davantage une confidence sur ma vie faite, à l’époque, à mon ex-femme avant de la rencontrer. Ce qui est cocasse, c’est que la publication du livre a joué un rôle déterminant dans notre séparation. Elle écrivait et voulait être écrivain. Elle a depuis été publiée plusieurs fois, mais à l’époque tous ses manuscrits étaient refusés. Quand mon texte écrit à la rigolade en Corse a trouvé un éditeur en deux mois, elle m’a accusé de lui avoir « volé sa vie », et à partir de ce moment-là, elle a refusé d’aborder toute question d’écriture avec moi tandis que c’était l’essentiel de nos conversations depuis presque dix ans. Ses parents m’ont interdit de mentionner l’existence du livre quand nous allions les voir. J’ai accepté. J’ai d’ailleurs attendu qu’elle soit publiée pour sortir un autre livre en 2013, mais cela n’a pas suffit. Entre 2006 – la publication de Pertes humaines – et 2013, la publication de La Disparition du monde réel, notre relation s’était tellement dégradée qu’il n’était plus possible de la sauver. A posteriori, je ne lui en veux pas. Si en faisant une vingtaine d’aquarelles comme une blague en vacances elle s’était retrouvée exposée chez Perrotin ou Zwirner à la rentrée, je lui en aurais aussi voulu à mort. On s’imagine capable de noblesse jusqu’à ce que la vie nous prouve que nous ne sommes que des cancrelats. Le pire dans toute cette histoire, c’est que nous nous aimions et que j’ai écrit ce livre pour l’impressionner, pour qu’elle se dise « Ce type est vraiment extraordinaire ! », alors même que nous étions déjà mariés et parents. J’aurais mieux fait de me contenter de peindre sans doute. Cela aurait épargné bien des séances de psy à nos enfants durant le divorce. Voilà ce que m’a coûté ce livre : mon mariage, ma famille. Plus tard, une fois publiée, mon ex-femme m’a confié que cela ne la rendait pas heureuse finalement. Mais il était trop tard. On rate sa vie comme ça parfois, en enviant la bonne fortune de ses proches. Lamentable n’est-ce pas ?
13 – Ta deuxième fiction, La Disparition du monde réel (Buchet Chastel, 2013) est une sorte de bilan de la « quarantaine », non pas concernant une mise à l’écart sanitaire, mais par l’âge. Ici, il s’agit d’une bande d’amis qui se retrouvent durant des vacances en Provence où « malgré l’humour et l’ivresse, le désenchantement gagne ». Il s’avère que le narrateur est divorcé, mais qu’il est également désabusé, déprimé, voire revenu de tout : de l’amour, du sexe, et même de l’amitié. Au moment où tu écris et publie ce livre, tu n’es pas dans cette situation. Tu en parles pourtant avec une certaine empreinte de « vécu ». À défaut d’autofiction, était-ce une sorte d’auto prophétie par rapport à ce que tu as vécu depuis ?
C’était une fiction d’anticipation, mais je l’ignorais. Tout c’est déroulé comme décrit deux ans plus tard. Était-ce un programme inconscient ? Je ne le crois pas. Plutôt un cauchemar prémonitoire. Il y a eu déjà plusieurs savants qui se sont penchés sur les pouvoirs divinatoires de l’écriture, je n’ai rien à ajouter là-dessus sinon que c’est un fait, je peux en témoigner. Je crois par ailleurs ; mais cela n’a rien à voir ; que c’est dans ce livre que ma langue peut se lire le mieux. Un très bon ami m’a dit que je possédais une « puissance formulaire » hors du commun. Je ne sais pas raconter les histoires, mais je sais faire onduler les phrases. Je l’affirme ici sans modestie parce que tout le monde me le dit.
14 – Ce qui retient chez toi, c’est ton écriture précise, ton langage élégant et souple qui te permettent de créer une véritable musique, une rythmique originale. Ton don pour les descriptions du quotidien, des petites choses intimes qui nous touchent et ton art de manier l’anecdote (vraie ou fantasmée) donne à ta prose un ton et un style bien particulier. Ton écriture a-t-elle à voir avec ta peinture et vice versa ? Qu’essaies-tu de construire comme œuvre littéraire ?
Non, j’adorerais peindre aussi naturellement que j’écris. Techniquement, j’écris mieux que je ne peins, mais je mène une véritable recherche en peinture. Tout ceci est prétentieux, mais techniquement, je ne vois plus l’intérêt de la jouer petit. J’ai essayé et l’on m’a tout de même crucifié pour oser peindre et écrire sous le même nom, comprendre : me poser trop de casquettes dorés sur la tête. À présent, ceux qui ne sont pas contents, je les encule en pensée. Si je les enculais pour de bon, ils y prendraient trop de plaisir. Si vous voulez savoir, un des rouages de ma façon d’écrire, c’est la fusion des registres. Je suis un enfant de prolétaires marseillais qui peut réciter Villon par cœur. Cela fait un mélange original. Quand vous posez les mots « bite » et « concussion » par exemple dans la même phrase, cela ne peut faire que des étincelles. Le respect petit-bourgeois pour la littérature avec un grand L, je ne l’ai pas. La littérature, c’est ma petite chienne, je t’attrape par les cheveux, je lui griffe le dos et je la tamponne avec le sourire jusqu’à ce qu’elle jouisse. Il y a trop de puceaux, de souffreteux, de coincés des deux sexes qui écrivent. D’ailleurs, si vous décortiquez les romans importants des trente dernières années, de Hervé Guibert à Virginie Despentes en passant par Catherine Millet ou Michel Houellebecq, rien ne s’écrit depuis une quelconque timidité, une sexualité morne, rien avec le pantalon plié sur la chaise ou un fond de culotte immaculé, rien depuis une vulgarité surjouée non plus, bien sûr, c’est tout l’exercice. C’est vraiment comme dans un lit. Si vous êtes trop sage, c’est mort, si vous êtes sans égards, c’est sordide. Alors, il me semble qu’au moment d’écrire il faut garder en tête à l’échelle du paragraphe qu’une petite claque sur les fesses fait toujours remonter le sang et s’agiter fort tous les fluides. Là, dans cette réponse, j’y suis allé peut-être un peu fort, mais cela fait partie du jeu, du jeu avec la limite. Un peu au-delà, mais à peine. Le lecteur apprécie la transgression contrôlée, pas le déchaînement furieux, qui toujours perd dans son désordre sa portée subversive et toute allure. Et puis, ce que j’aime quand j’écris, c’est que la fin de la phrase soit impossible à deviner, ça c’est essentiel. Il faut contrecarrer la diachronie de l’écrit, sinon c’est cuit. Le lecteur ne doit pas courir plus vite que nous. En fin de phrase, c’est l’écrivant qui doit arriver le premier, toujours. C’est souvent par la prise de contrôle initiale de l’horizon d’attente du lecteur que toute surprise est rendue possible. On promet, mais on délivre autre chose que ce qui était promis. La sensation délicieuse d’avoir été baladé, on ne peut la procurer qu’avec le réflexe constant de dérouter. C’est assez facile à faire une fois que l’on a pigé le truc, il suffit par exemple de terminer une phrase en apparence intelligente en écrivant « Pouet pouet ! ». Vous voyez, c’est facile !
15 – Cela fait presque sept ans maintenant que tu n’as pas publié de nouveau texte fictionnel. Est-ce à cause des aléas de la vie, ou bien parce que tu sens au fond qu’écrire de la fiction est frustrant par rapport à d’autres pratiques, à d’autres médiums, sinon même par rapport à elle-même, ne suscitant guère plus d’intérêt, ni d’enthousiasme dans la société qui affiche une assez forte haine « littéraphobique » ? Avec du recul, et les épreuves de la vie que tu as traversées, assumes-tu toujours ces deux livres ? Les réécrirais-tu encore aujourd’hui ?
Comme je le disais précédemment, être publié m’indiffère. Cela ne me procure aucun plaisir, c’est humainement salissant, et c’est économiquement une expérience ridicule. À l’occasion j’essaierai de faire publier un autre texte, pour qu’il soit facile d’accès et archivé sous ISBN, mais sinon ce n’est pas important dans ma vie. Ces dernières années ont été de loin les pires de mon existence, et j’ai eu une enfance terrible, une adolescence à l’hôpital, qui m’avaient laissées supposer un peu naïvement que le pire était derrière moi. J’avais tort. Je me remets cependant lentement, mais surement, de cette période abominable. Alors oui, la vie a été trop dure pour me laisser le loisir de m’en plaindre, comprendre « écrire », puisque je n’ai jamais rien écrit de bien optimiste. Je suis aussi devenu intolérant au drame comme d’autres le sont au gluten. Je ne supporte plus les gens tordus, les vicieux, les salopes, les hypocrites, les arrivistes, les menteurs, les âmes sales, un peu sadiques, toute la fange humaine. Cela fait du monde. Décrire cette sous-espèce parce qu’elle est majoritaire me dégoûte à présent. Ils ne méritent pas notre attention ni nos livres. Je me concentre maintenant sur les rares, les doux, les bons, les vrais. Or j’ignore si je suis capable d’une écriture du bonheur. Je me suis retenu de poursuivre sur ma lancée crépusculaire, c’est déjà la moitié d’une métamorphose. J’aimerais rencontrer une femme, ça ne peut être qu’une femme, qui m’inspire une poésie bucolique, des phrases qui sourient confiantes, qui fasse s’assoir mes mots sur une plage rêvée des Pouilles, loin de tout, au grand soleil tout bleu, la peau halée-sablée-salée. Je ne veux plus écrire avec des torrents de regrets et de larmes rentrés, je veux écrire avec de l’écran solaire sorti en mayonnaise, de la polenta grillée et l’humidité unique des baisers sincères. Je veux écrire depuis l’insouciance, l’harmonie, me mettre au service de l’anti mélancolie. Malgré quelques belles rencontres, j’attends cette « muse » (appelons un chat un chat). On en est presque tous là ceci dit. Si elle surgit, j’écrirai afin de célébrer cette délivrance du plancher des vaches, si elle ne paraît jamais, vous n’entendrez plus parler de moi. Je ne dois rien à personne, rien à mon talent, rien à la vie. Un jour, je ne serai plus là, et personne ne s’en apercevra. Ce sera très bien, très discret, très élégant.
16 – La chaîne Arte a consacré en 2015 un documentaire à ton travail de peintre et le magazine L’Œil t’a inclus dans leur sélection d’un numéro intitulé « Qui sont les peintres de demain ? ». N’était-ce que ce simple quart d’heure de célébrité comme Andy Warhol avait prévu que nous aurions chacun le nôtre, ou bien un réel signe de reconnaissance de ton travail ? Quels sont tes projets pour l’avenir ? Comment comptes-tu continuer à peindre, à écrire, à exprimer à diffuser et à mettre en forme tes idées, tes impressions, ton art ? Comment vois-tu la continuité de l’art dans notre monde à l’heure de sa globalisation disruptive, sinon par sa réification comme objet de conso, support publicitaire, contenu spectaculaire, ou au contraire, par sa revalorisation spirituelle et sa renaissance sociale, d’une manière plutôt imprévue et que nous ne sommes pas capables, à ce jour, de concevoir encore ?
La reconnaissance est une forme dérisoire d’amour diffus. Je dois avouer que je le préfère concentré, façon Pulco citron. Ceux qui veulent être aimés par tout le monde sont incapables d’aimer exclusivement, d’aimer pour de bon. Ils se vouent aux foules, aux premiers venus, aux derniers partis, au nombre. Ils refusent de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ils sont peut-être raison, mais ils sont toujours seuls à la vérité, férocement isolés. Mon goût de la permanence et de l’exclusivité n’y trouve pas son compte. Enfin, une vie comporte des hauts et des bas, des coups de chance et de malchance. Un CV, c’est de l’écume à la surface d’une marre de pisse. L’argent à choisir, lui, est un véritable étalon, il permet de s’acheter des voitures de luxe, de les revendre, de se payer des filles de rêve et des palais vénitiens. Il est la clé de tous les simulacres tangibles. La célébrité, elle, est une illusion strictement « médiatique ». On peut compter sur les objets, pas sur le reste. Je ne sais pas si je suis très clair. Ce n’est pas très grave. Nous nous connaissons depuis longtemps, sans cela, je n’aurais pas répondu à ces questions. Cet entretien, j’y ai consacré du temps parce que vous faites partie des personnes exceptionnelles que j’ai croisées dans ma vie. J’y ai répondu pour vous, j’y ai répondu par amour, et pour faire semblant de ressusciter. J’ai l’âme épuisée d’origine, comme tous les enfants non désirés. Je m’y suis fait.”
Texte © Les auteurs – Illustrations © Marc Molk – Photographie © DR
(Paris, janv. 2018-nov. 2019)
********************************
Read the interview on the D-Fiction website : https://d-fiction.fr/entretien-avec-marc-molk/